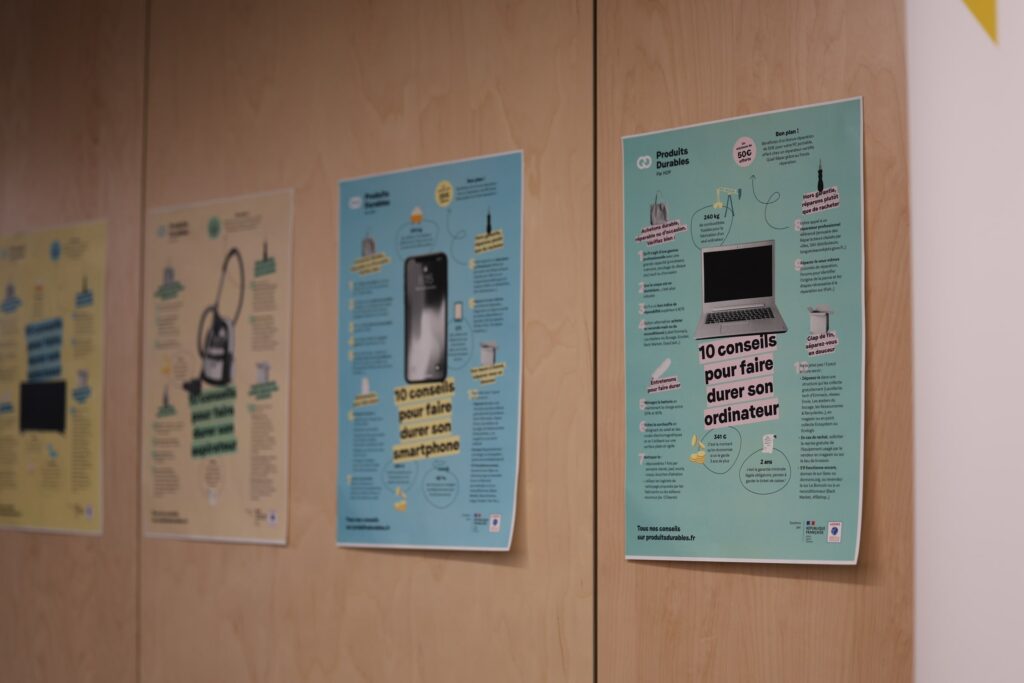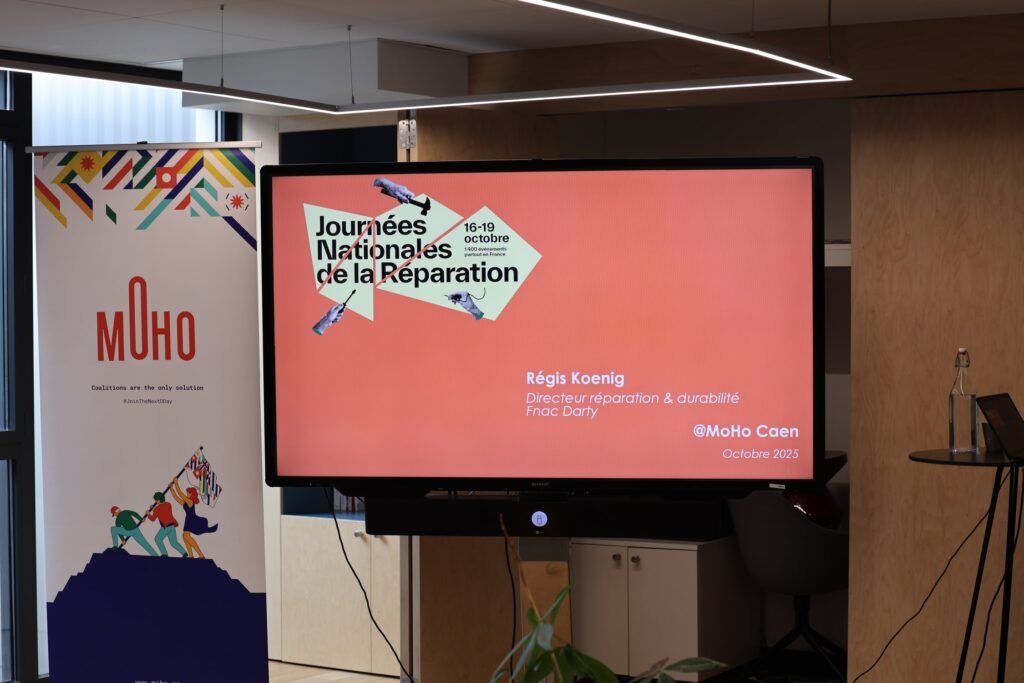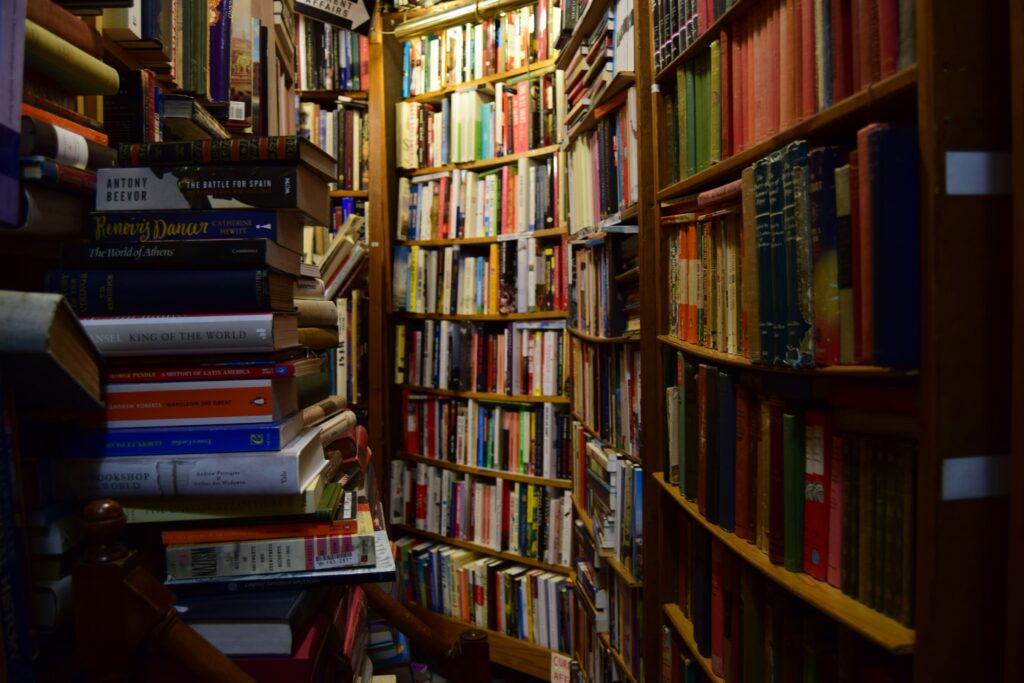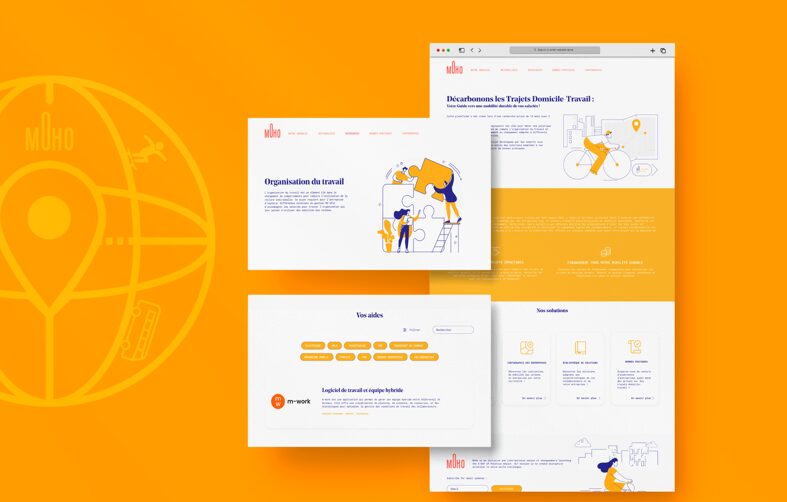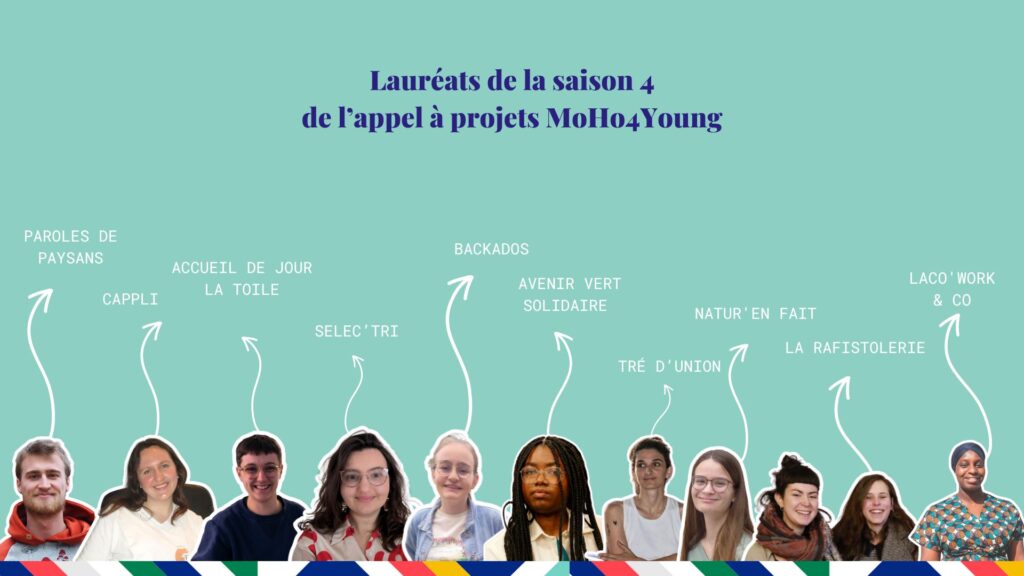Dans le cadre des Rencontres Architectures et Territoires organisées par l’Ordre des Architectes de Normandie, MoHo a eu le plaisir d’accueillir le jeudi 13 novembre 2025 Corentin de Chatelperron, ingénieur, explorateur et fondateur du Low-Tech Lab, pour une soirée exceptionnelle autour des innovations simples, utiles et durables qui questionnent notre manière d’habiter la planète.
Durant cette soirée, Corentin a partagé son parcours d’explorateur et d’ingénieur, ses expéditions à bord du Nomade des Mers, ainsi que la genèse de la Biosphère Urbaine, un projet innovant qui combine technologies accessibles, vivant et résilience pour repenser notre manière d’habiter la planète. Retour sur une conférence captivante qui encourage à imaginer un futur plus sobre et désirable.
Cet événement s’est inscrit dans le cadre de l’Action Territoriale 2025 “Ménager un monde vivant”, coorganisée par Ordre des Architectes de Normandie, le MoHo, le Réseau Low-Tech Normandie, Le Dôme – Centre de sciences Caen Normandie et POPSU – Plateforme d’observation des projets et stratégies urbaines, Ville de Caen, et le laboratoire CERREV (Université de Caen Normandie).
La low-tech : penser mieux avec moins
Derrière le concept de low-tech se cache une idée simple mais puissante : utiliser l’ingéniosité humaine pour répondre aux besoins essentiels avec des moyens accessibles, durables et adaptés à notre environnement. La low-tech n’est pas seulement une question de technique, mais aussi de démocratie et de lien social, invitant chacun à réapprendre à interagir avec son milieu et à repenser sa consommation.

L’ingéniosité des contraites : le parcours de Corentin de Chatelperron
Ingénieur diplômé de l’ICAM à Nantes, Corentin de Chatelperron a débuté sa carrière au Bangladesh sur des chantiers navals, où il découvre comment les contraintes créent de l’ingéniosité. Confronté aux impacts environnementaux des industries locales, il comprend qu’il est possible de faire mieux avec moins et que cette démarche n’est pas enseignée dans les écoles d’ingénieurs classiques.
Il définit la low-tech comme toute technologie ou savoir-faire qui répond à trois critères : utile, accessible et durable. Son objectif : trouver ces solutions dans le monde entier et les partager librement.
Le Low-Tech Lab et le voyage autour du monde
Pour concrétiser cette vision, Corentin crée le Low-Tech Lab, dont le premier projet a été la transformation d’un catamaran en laboratoire flottant. Pendant six ans, l’équipe parcourt le monde, rencontre des communautés, documente et teste des solutions low-tech, de l’aquaponie aux systèmes de compostage innovants, en passant par des synergies avec d’autres espèces vivantes.
Chaque expérimentation montre que s’associer au vivant permet souvent de remplacer des machines ou des processus complexes, et d’atteindre des modes de vie plus résilients.
De l’expédition à l’habitat-écosystème
Fasciné par les expériences de biosphères fermées, Corentin a voulu créer une version low-tech et accessible, capable de fonctionner dans des environnements hostiles. Avec l’ingénieure Caroline Pultz, ils ont testé un écosystème de 60 m² dans un désert, combinant plantes, champignons, insectes et systèmes low-tech pour gérer eau, énergie et déchets.
Cette expérience a montré qu’en comptant sur le vivant et sur des technologies simples, on peut concevoir un habitat sobre, autonome et désirable. Elle a aussi permis de mesurer l’importance de l’empathie inter-espèces et des cycles naturels pour repenser notre rapport au monde.

La Biosphère Urbaine : expérimenter en ville
La Biosphère Urbaine est le fruit d’années d’expérimentations et de voyages autour du monde menés par Corentin de Chatelperron et son équipe.
Après avoir testé différentes innovations low-tech dans des contextes extrêmes, Corentin de Chatelperron et Caroline Pultz se sont installés pendant quatre mois dans un appartement de 26 m² à Boulogne-Billancourt, transformé en véritable habitat-écosystème.
L’objectif était de mettre en pratique toutes les solutions développées et documentées au cours des années : gestion minimale de l’énergie et de l’eau, recyclage des déchets, production alimentaire locale et durable, et association avec des espèces vivantes pour créer des synergies naturelles. Chaque détail, de la douche champignonnière à la cocotte vapeur des repas, a été pensé pour tester des modes de vie sobres, résilients et désirables.
La biosphère en chiffres :
- Durée de l’expérience : 4 mois
- Lieu d’expérimentation : appartement de 26m2 à Boulogne-Billancourt
- Consommation d’eau divisée par 12
- Seule source d’énergie : 4m2 de panneaux solaires
- Consommation d’énergie divisée par 15
- 10 min par jour d’entretien en moyenne
- 1kg de pleurotes produites par semaine
Aujourd’hui, l’expérience se prolonge au MoHo, où l’exposition Biosphère Urbaine invite le public à découvrir ces systèmes et pratiques en immersion. Les visiteurs peuvent explorer chaque module de l’appartement-écosystème, comprendre le fonctionnement des innovations low-tech, et s’inspirer de ces solutions pour repenser leur quotidien et l’habitat urbain de demain.

L’exposition est au MoHo jusqu’au 5 janvier 2026 (entrée libre et gratuite).
Cette exposition s’inscrit dans le cadre de l’Action Territoriale 2025 “Ménager un monde vivant”, coorganisée par Ordre des Architectes de Normandie, le MoHo, le réseau Low-Tech Normandie, Le Dôme – Centre de sciences Caen Normandie et POPSU – Plateforme d’observation des projets et stratégies urbaines, Ville de Caen, et le laboratoire CERREV (Université de Caen Normandie).
Sciences participatives et engagement citoyen
Cette expérimentation a permis de mesurer concrètement l’impact de ces innovations sur l’empreinte écologique, la santé, et le bien-être quotidien, tout en impliquant des experts et le grand public à travers des missions de sciences participatives, volet clé de la Biosphère Urbaine.
Les habitants et le grand public sont invités à tester des solutions low-tech, expérimenter des missions concrètes et partager leurs retours. En 2024, plus de 800 missions ont été réalisées par des participants volontaires, encadrés par des experts.
Cette approche montre que changer nos modes de vie collectivement est possible lorsque l’on combine innovation, éducation et engagement citoyen.
Changer les imaginaires : vers un futur désirable
Au-delà des techniques et des systèmes, Corentin insiste sur la nécessité de changer notre imaginaire du futur. Les villes de demain doivent être pensées comme des lieux sobres, durables et agréables à vivre, où le lien social et la coopération avec le vivant sont au cœur de la conception.
L’expérience montre qu’un futur désirable peut se construire aujourd’hui, à condition d’allier créativité, partage des savoirs et pratiques accessibles.