Du 16 au 22 septembre 2025 a lieu la semaine européenne de la mobilité durable. Chaque année, cet événement invite citoyens et collectivités à tester des modes de transport plus durables (marche, vélo, transports en commun, covoiturage) et à repenser leurs habitudes quotidiennes. Au-delà d’un rendez-vous symbolique, il s’agit d’encourager une mobilité sobre qui gagne à s’inscrire toute l’année dans notre quotidien pour réduire nos émissions, améliorer la qualité de vie et réinventer nos façons de nous déplacer.
En France, le transport représente environ 30 % des émissions de gaz à effet de serre (Ministère de la Transition écologique, 2024), repenser nos déplacements est donc un levier essentiel de sobriété écologique.
Se déplacer moins, mais mieux
Nos déplacements structurent nos vies quotidiennes. Ils déterminent où nous travaillons, où nous habitons, nos loisirs, nos relations sociales. Mais la mobilité telle qu’elle s’est développée pendant les dernières décennies, centrée sur la voiture individuelle et l’avion, est l’un des principaux moteurs de la crise climatique en raison des émissions de gaz à effet de serre.

Face à cette réalité, la sobriété dans la mobilité ne veut pas dire arrêter de bouger. Elle consiste à se déplacer autrement : moins souvent, moins loin, moins vite… mais de manière plus efficiente, plus responsable et plus partagée.
La mobilité active : redonner place à la proximité et à la santé
Dans les villes, la marche et le vélo reprennent une place centrale. Un rapport de l’Ademe (2023) estime que 60 % des trajets urbains en voiture pourraient être remplacés par des trajets à vélo ou à pied. En 2023, le gouvernement français a notamment annoncé un Plan vélo et marche doté de 2 milliards d’euros, visant à tripler les déplacements à vélo d’ici 2030.
Le vélo-cargo est en plein essor, surtout dans les villes : les familles transportent enfants et courses, les professionnels transportent du matériel, les commerces livrent les clients.

Cette mobilité active n’est pas qu’écologique : elle est aussi source de santé publique. L’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) rappelle qu’une activité physique quotidienne réduit drastiquement les risques de maladies chroniques.
Transports collectifs : la sobriété par la mutualisation
Train, tramway, bus… autant de solutions collectives qui permettent de réduire l’empreinte carbone de nos déplacements. En France, la relance du ferroviaire est une tendance forte depuis 2021, avec le retour des trains de nuit (comme Paris-Nice, Paris-Berlin ou encore Paris-Vienne). L’Union européenne soutient cette dynamique avec l’initiative RTE-T (Réseau Transeuropéen de Transport) pour recréer un réseau ferroviaire européen interconnecté.

À l’échelle locale, les bus à haut niveau de service (comme à Metz, Nantes, Rouen) montrent qu’il est possible de repenser la mobilité urbaine autour de lignes performantes, fréquentes, moins polluantes (hybrides, électriques ou hydrogène).
Le transport collectif est un exemple parfait de sobriété collective avec moins d’espace consommé, moins de bruit, moins de stress et plus de convivialité.
La voiture autrement : partage et usage raisonné
À elle seule, la voiture individuelle génère plus de 15 % des émissions de gaz à effet de serre en France (Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, 2022).
La voiture individuelle reste indispensable dans certains territoires ruraux et périurbains. Mais là aussi, il existe des leviers pour changer ses usages et réduire son empreinte carbone lié à l’utilisation de la voiture :
- Covoiturage : Il existe un fort levier de réduction des émissions de gaz à effet de serre des transports sur les trajets domicile-travail. Les trajets professionnels en voiture se font très majoritairement avec un seul conducteur sur de courtes distances (88 %). L’autosolisme reste également courant pour d’autres déplacements locaux non récréatifs, comme les courses (41 %) ou les démarches administratives et médicales (50 %) (SDES-Insee, Enquête mobilité des personnes 2018-2019).

- Autopartage : Le parc de véhicules partagés croît chaque année en France : au 1er janvier 2025, 13 862 voitures en autopartage étaient disponibles sur le territoire, soit une hausse de 3,7 % par rapport à 2024 (Baromètre national de l’autopartage, 2025).
- Électrification raisonnée : si la voiture électrique se développe, il est essentiel de rappeler qu’elle n’est pas une “solution miracle” : extractions minières, empreinte carbone de fabrication, dépendance aux infrastructures.
Le défi de repenser nos modes de déplacement est aussi social afin de rendre cette transition accessible aux ménages modestes. Les zones à faibles émissions (ZFE), mises en place dans les grandes métropoles, posent la question de l’accompagnement des habitants qui n’ont pas les moyens de changer de véhicule. Une sobriété écologique et responsable ne doit pas être punitive, mais inclusive.
Réduire les distances
Parmi tous les moyens de transport, l’avion se distingue par son impact environnemental extrêmement élevé, avec des émissions de CO₂ par passager bien supérieures à celles du train, du bus ou de la voiture partagée. Le trafic aérien mondial a déjà retrouvé et dépassé en 2024 son niveau d’avant la pandémie de Covid-19. Dans le même temps, le débat public s’intensifie autour de la limitation des vols courts lorsqu’une alternative en train existe. Le problème réside souvent dans le coût du transport pour les passagers, souvent bien moins élevé pour l’avion que pour le train. En France, la loi Climat et résilience (2021) a interdit certains vols domestiques, remplacés par des liaisons ferroviaires.
Mais la sobriété, c’est aussi se déplacer moins. Le télétravail, expérimenté massivement depuis le début de la crise sanitaire du Covid-19 en 2020, en est un exemple : des millions de trajets domicile-travail ont été supprimés. Cependant, les bénéfices écologiques de cette pratique sont partiellement compensés par des effets rebonds : consommation d’électricité et de chauffage à la maison, trajets annexes au trajets domicile-travail quand même effectués (enfants, courses…).

La question de la réduction des distances va plus loin : dans un monde sobre, il s’agit aussi de rapprocher les lieux de vie, de travail, de loisirs, afin de limiter les besoins de transport à la source. C’est la logique de la “ville du quart d’heure” défendue par l’urbaniste Carlos Moreno : une ville où tout est accessible à 15 minutes à pied ou à vélo.
Changer les imaginaires autour de la mobilité
Pour que la sobriété devienne désirable, il faut aussi transformer l’imaginaire collectif. Pendant un siècle, la publicité automobile a imposé l’idée que la voiture individuelle était synonyme de liberté. Aujourd’hui, il est essentiel d’explorer de nouveaux récits : liberté de se déplacer ensemble, de redécouvrir la proximité, de réinvestir le temps du trajet comme un espace social.
La géographe Cynthia Ghorra-Gobin souligne dans ses travaux que la mobilité n’est pas seulement une question d’infrastructures, mais aussi de justice spatiale : qui a accès à quels modes de transport, à quels coûts, et pour quelles libertés réelles (Le « triomphe » de la ville ou de la métropole ?, 2015).
MoHo agit concrètement sur la mobilité domicile-travail
MoHo a initié et coordonné la Coalition Mobilité Durable, qui a conduit à la création de Move2Work : une plateforme numérique gratuite destinée aux employeurs souhaitant réduire l’impact carbone des trajets domicile-travail de leurs salariés et améliorer leur qualité de vie et conditions de travail. Move2Work offre une méthodologie complète intégrant à la fois l’organisation du travail, l’accompagnement au changement, une bibliothèque de solutions et une base de bonnes pratiques. Fruit d’une recherche-action de 18 mois qui a fédéré entreprises, acteurs publics, chercheurs, étudiants et associations, cet outil permet de recenser plus de 100 solutions clés en main, de communiquer efficacement sur les changements d’habitudes, et de lancer des projets concrets dans les organisations.
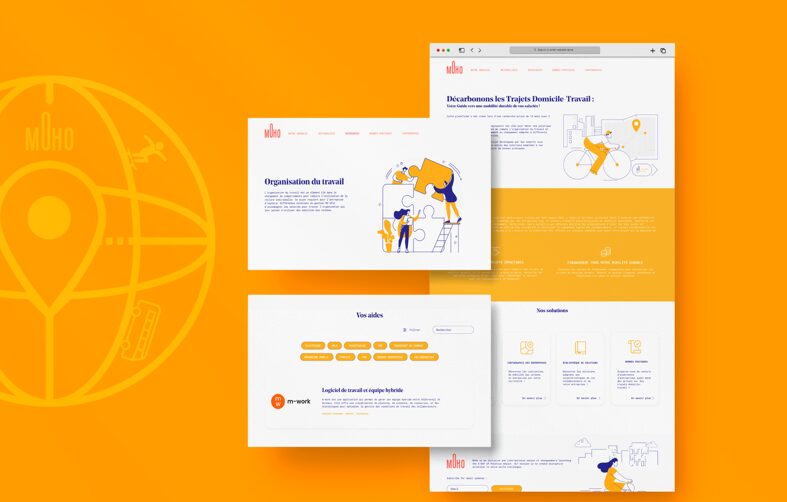
Un avenir désirable
La mobilité sobre dessine un quotidien où :
- on marche ou pédale pour les trajets courts, et on y gagne en santé et en convivialité,
- on privilégie les transports collectifs, et on y gagne en efficacité et en équité,
- on utilise la voiture quand c’est nécessaire, mais en partageant notre trajet dès que possible,
- on abandonne les voyages en avion, et on découvre les richesses de territoires plus proches.
La sobriété appliquée aux déplacements ne veut pas dire “se priver de voyager”, mais réapprendre à se déplacer pour vivre mieux, respecter la planète, se libérer des dépendances à la voiture individuelle et du désir d’aller toujours plus vite, plus loin, au détriment de la planète.
